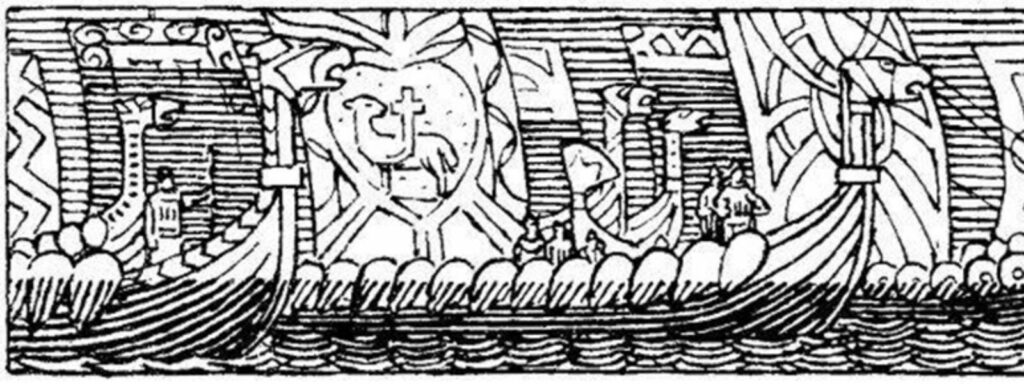Le 14 août
14 août 1040 : Macbeth s’empare du trône d’Écosse
Le 14 août 1040, en un lieu nommé Bothgowanan, le roi d’Écosse Duncan 1er est assassiné par un parent, un rude guerrier du nom de Macbeth, lequel prend sa place sur le trône.
Les deux jeunes fils de la victime n’ont de cesse de venger leur père. Ils s’allient pour cela au roi d’Angleterre, le Saxon Édouard le Confesseur.
En 1056, à Dunsinnan, au terme d’un violent affrontement entre les deux armées, Macbeth est battu. Il s’enfuit avant d’être tué par l’un de ses anciens ennemis le 15 août 1057, en un lieu dit Lumphanan. L’héritier de Duncan peut enfin retrouver son trône sous le nom de Malcolm III. Cette tragédie des temps barbares aurait été bien oubliée si elle n’avait été bien plus tard mise en vers par Shakespeare.
14 août 1385 : Les Portugais triomphent à Aljubarrota
Le 14 août 1385, la bataille d’Aljubarrota assure l’indépendance du Portugal, menacée par des querelles de succession.

Ferdinand 1er le Beau, roi du Portugal et d’Algarve, n’a laissé à sa mort, le 22 octobre 1383, qu’une fille mariée à son voisin, le roi de Castille Jean 1er. Craignant que les Castillans ne fassent main basse sur leur petit royaume, les députés des Cortes de Coïmbre (ou Coïmbra) portent aussitôt sur le trône un fils illégitime de l’ancien roi Pierre 1er, Jean le Bâtard, sous le nom de Jean 1er (Joao 1er).
Mais le roi de Castille n’en a cure. Soutenu par sa femme Béatrice et sa belle-mère Éléonore, veuve de Ferdinand 1er, il franchit la frontière avec son armée.
Son équipée s’arrête à Aljubarrota, sur la route de Lisbonne, où elle est défaite par l’armée portugaise, commandée par le connétable Nuno Alvares Pereira et renforcée par un petit contingent d’archers anglais.
En témoignage de reconnaissance à ses alliés anglais, le roi Jean 1er signe avec eux, en mai de l’année suivante, le traité de Windsor qui établit une « ligue d’amitié inviolable, éternelle, solide, perpétuelle et véritable » entre les deux royaumes. Cette alliance est la plus ancienne encore en vigueur !
14 août 1844 : Bataille de l’Isly
Le 14 août 1844, les troupes marocaines, alliées de l’émir Abd el-Kader, sont surprises par le général Thomas Bugeaud sur l’oued Isly, non loin de la frontière algéro-marocaine. Les 11 000 soldats français mettent en déroute les 60 000 cavaliers marocains.
Cette bataille est le point d’orgue de la guerre menée par les Français en Algérie depuis leur débarquement près d’Alger, en 1830. Elle sonne le glas de la lutte conduite par Abd el-Kader mais celui-ci et beaucoup d’autres de ses concitoyens résisteront encore plusieurs années à l’occupant avant de faire leur reddition.
Alban Dignat
Une Vendée musulmane
Le 10 septembre 1844, par le traité de Tanger, le Maroc lâche Abd el-Kader et entérine le tracé de sa frontière avec l’Algérie.
Les habitants de l’Algérie ne s’avouent pas vaincus pour autant. Dans le massif du Dahra, à l’est de Mostaganem et d’Oran, les paysans se soulèvent à l’appel d’un Berbère surnommé « Bou Maza »(l’homme à la chèvre). La réaction de l’armée française ne se fait pas attendre. Des « colonnes infernales » ravagent la contrée. Les chefs de la résistance se rendent les uns après les autres.
Abd el-Kader lui-même, épuisé et isolé, se rend le 23 décembre 1847 aux généraux de Lamoricière et Cavaignac. Sa reddition ne met pas totalement fin aux hostilités. Une résistance sporadique va perdurer pendant encore une dizaine d’années avant que l’Algérie, exsangue, ne soit occupée dans sa totalité par l’armée française.
La conquête de l’Algérie, seule guerre notable du règne somme toute pacifique de Louis-Philippe 1er, aura en définitive mobilisé jusqu’à 93 000 soldats. C’était beaucoup pour soumettre une population rurale et pauvre d’à peine 3 millions d’individus (la France comptait à la même époque 36 millions d’habitants).
Le général Bugeaud s’en explique en qualifiant l’Algérie de « Vendée musulmane », avec la même résistance… et la même répression que dans la véritable Vendée catholique ! Lui-même reçoit son bâton de maréchal pour ses faits de gloire en Algérie. Il est fait duc d’Isly par le roi et il ne lui est pas tenu rigueur des nombreux crimes de guerre commis sous son commandement contre les civils algériens.
Odieuses « enfumades »
À Paris, dans la rue comme à la Chambre des Pairs, on s’indigne lorsqu’on apprend que des centaines de malheureux de la tribu des Ouled Riah ont péri le 19 juin 1845 dans l’« enfumade » des grottes du Dahra, à l’initiative du colonel Pélissier.
Le général Bugeaud, interpellé, assume la responsabilité de ce crime de guerre en faisant valoir qu’il était justifié par la conduite des opérations : le colonel avait proposé une reddition honorable aux combattants et à leurs familles qui s’étaient réfugiés dans les grottes. Devant leur refus, et considérant qu’il ne pouvait prendre le risque de les laisser aller, il avait enfumé les grottes en espérant de la sorte les en faire sortir. Las, hommes, femmes et enfants étaient morts, presque tous asphyxiés. Les chroniques militaires relatent selon l’historien Daniel Lefeuvre deux ou trois autres faits semblables.
Début de la colonisation
Dans l’Algérie enfin soumise, les colons commencent à s’implanter en grand nombre.
L’administration du pays a été confiée dès 1833 aux bureaux des Affaires arabes. Ces bureaux militaires prennent en charge les intérêts des indigènes et défendent tant bien que mal leurs droits et leurs propriétés. Mais au fil du temps, leurs efforts se heurtent à la volonté des gouvernements de transformer l’Algérie en une colonie de peuplement.
C’est ainsi que l’État ou l’armée enlèvent des terres aux indigènes, construisent à leurs frais des villages entièrement équipés avant de les remettre clés en main à des soldats en voie de démobilisation ou à des groupes de pauvres colons en provenance de la France de l’intérieur, de Malte, d’Italie ou encore d’Espagne.
Les pouvoirs publics constituent aussi de vastes domaines et les confient à des bourgeois venus de France, ces derniers employant sur leurs terres comme fermiers les indigènes musulmans qui en étaient auparavant les propriétaires.
Les immigrants européens sont appelés roumis (roumias pour les femmes) par les indigènes, d’un mot arabe qui désigne traditionnellement les chrétiens d’Occident, descendants des Romains (ils seront beaucoup plus tard qualifiés de Pieds-noirs par leur coreligionnaires de la métropole).
Espoirs et faillite de l’intégration politique
En rupture avec les régimes précédents, l’empereur Napoléon III tente de transformer le territoire algérien en un « royaume arabe » associé à la France et dont il serait lui-même le souverain.
Dans une lettre du 6 février 1863, il proclame que « l’Algérie n’est pas une colonie proprement dite mais un royaume arabe ». Au grand scandale des colons et des militaires, il en appelle à l’égalité complète entre Européens et indigènes, au moins dans la gestion des affaires locales. Par ailleurs, un sénatus-consulte(une loi) en date du 14 juillet 1865 permet aux musulmans d’acquérir la citoyenneté française mais à la condition de renoncer à titre individuel au statut coranique et d’accepter le droit civil français.
La chute de l’Empire, en 1870, va ruiner le projet de Napoléon III et creuser le fossé entre indigènes et colons.
14 août 1900 : Un corps expéditionnaire à Pékin
Le 14 août 1900, un corps expéditionnaire européen entre à Pékin. Les diplomates assiégés par les Boxeurs (en anglais : Boxers) sont délivrés. Le gouvernement de l’impératrice Ci Xi (Ts’eu-Hi), qui avait encouragé en sous-main les émeutiers, est condamné à payer des indemnités jusqu’en… 1940. La Chine à demi-colonisée est une fois de plus humiliée.
14 août 1914 : La « bataille des frontières »
L’empereur Guillaume II ayant déclaré la guerre à la France le 3 août 1914, les Français imaginent comme les Allemands une guerre fulgurante et croient encore aux vertus de la cavalerie et des charges d’infanterie.
Joseph Joffre, commandant en chef des armées du nord et de l’est en 1911, applique sans barguigner le plan XVII, concocté en 1913, qui prévoit une offensive dans les Ardennes et en Lorraine.
Mais il est pris de court par l’offensive allemande en Belgique. Sans perdre de temps, l’armée de paix du général von Emmich, à pied d’oeuvre à la frontière, se lance à l’assaut des douze forts qui entourent Liège, sur les bords de la Meuse. Pendant ce temps s’achève la mobilisation des conscrits dans toute l’Allemagne avec la concentration et le regroupement des cinq armées requises par le plan Schlieffen pour l’invasion de la Belgique.
La surprise vient des Belges, qui résistent de façon inattendue à cette soudaine attaque allemande. Les Allemands finissent néanmoins par s’emparer de Liège le 16 août. Le lendemain, les armées de von Moltke peuvent comme prévu s’avancer en Belgique.
À Dinant et à Charleroi, deux armées allemandes en route pour Namur se heurtent à la 5e armée française du général Charles Lanrezac. Cet officier de talent a peu de goût pour l’offensive à outrance prônée par le général Joffre. Plutôt que de s’obstiner à défendre la ligne Charleroi-Namur et de prendre le risque d’être débordé sur ses flancs gauche et droit, il choisit de décrocher sans en référer à son supérieur. Cela lui vaudra d’être « limogé » quelques semaines plus tard.
De fait, à cause de lui et malgré l’arrivée des Anglais, à pied d’oeuvre dès le 21 août, les armées françaises doivent se résigner à reculer vers l’ouest mais ce faisant, elles échappent à un encerclement qui leur eut été fatal. Lanrezac a évité le pire pour son camp.
En Belgique comme en Lorraine, la « bataille des frontières » débouche sur une sévère défaite des Français et de leurs alliés. Les combats, à l’ancienne, avec charges à la baïonnette, en uniformes de couleur, képis et pantalons garance (rouge), se soldent par des pertes très importantes face à un ennemi qui, déjà, utilise massivement les mitrailleuses (200 000 hommes tués, blessés ou capturés en trois semaines).
Avec au moins 25 000 morts du côté français, le 22 août 1914 est la journée la plus meurtrière de toute l’Histoire militaire de la France !
Joffre organise toutefois une retraite générale en bon ordre qui laisse très peu de prisonniers aux Allemands. Le spectre d’une défaite totale, comme en 1870, se profile mais les troupes vont montrer qu’elles ont du ressort.
14 août 1941 : La Charte de l’Atlantique
Le 14 août 1941, tandis que l’Angleterre résiste seule à l’Allemagne nazie et que celle-ci vient d’envahir l’URSS, le président des États-Unis Franklin Delano Roosevelt et le Premier ministre britannique Winston Churchill se rencontrent à bord du navire de guerre Prince of Wales « quelque part en mer », au large de Terre-Neuve.
Ils proposent une série de principes moraux devant guider les puissances démocratiques et garantir le rétablissement durable de la paix :
• refus de tout agrandissement territorial,
• droit des peuples à choisir leur forme de gouvernement,
• libre accès de chacun aux matières premières,
• liberté des mers,
• renonciation à la force !
Le président américain veut de la sorte préparer son opinion publique, encore très réticente, à une entrée en guerre contre l’Allemagne, aux côtés de l’Angleterre et de l’URSS.
Principes virtuels
Le document signé par les deux dirigeants est connu sous le nom de Charte de l’Atlantique. Il est à l’origine de la charte des Nations Unies.
Mais il semble que les généreux principes de la Charte aient été contournés dès l’année suivante, lors de la signature du traité d’assistance anglo-soviétique de Londres, le 26 mai 1942. Par ce traité d’alliance entre le Secrétaire aux Affaires étrangères Anthony Eden et son homologue soviétique Viatcheslav Molotov, le premier concède au second le droit à un glacis de sécurité et à des frontières stratégiques.
De fait, la Charte de l’Atlantique est évoquée à la conférence de Yalta, en février 1945, mais seulement pour la forme, les participants de ladite conférence – Staline le premier – n’ayant eu aucune intention de renoncer aux agrandissements territoriaux ni de laisser aux peuples le droit de choisir leur forme de gouvernement.
Alban Dignat
C’est sa fête : Évrard
Cet ermite suisse du nom d’Eberhard ou Évrard qui vivait à l’époque carolingienne avait fondé avec ses confrères du voisinage un monastère à Einsiedeln.
Naissance
Pie VII
14 août 1740 à Cesena (Italie) – 20 août 1823 à Rome (Italie)
Le moine bénédictin Barnabé Chiaramonti, proche de sa famille et réputé pour sa douceur et sa bonté, est élu pape le 14 mars 1800 à Venise sous le nom de Pie VII, à 59 ans…
Décès
Randolph Hearst
29 avril 1863 à Sanf Francisco (États-Unis) – 14 août 1951 à Beverly Hills (États-Unis)
Fils unique d’un milliardaire qui a fait fortune dans les mines, William Randolph Hearst se fait offrir par son père, à 25 ans, le San Francisco Examiner et en fait le plus grand journal à sensation des États-Unis.
En quelques années, par des rachats successifs dans tout le pays, il se retrouve à la tête d’un empire de 28 journaux, 18 magazines, sept stations de radio, l’agence International News Service et une entreprise de cinéma, la Hearst Movie Productions.
Ce magnat de la presse ne va pas craindre de provoquer une guerre contre l’Espagne pour accroître ses tirages. Pendant la Première Guerre mondiale, il militera pour l’isolationnisme, heureusement en vain…
Marié et père de 5 enfants, il quitte à 55 ans le domicile familial avec une jeune maîtresse de 20 ans, Marion Davies. Émule de Louis II de Bavière, il bâtit pour elle, dans sa résidence de San Simeon, sur la côte méridionale de la Californie, un château exubérant et fantasque.
William Randolph Hearst a inspiré au cinéaste Orson Welles le héros du film Citizen Kane.